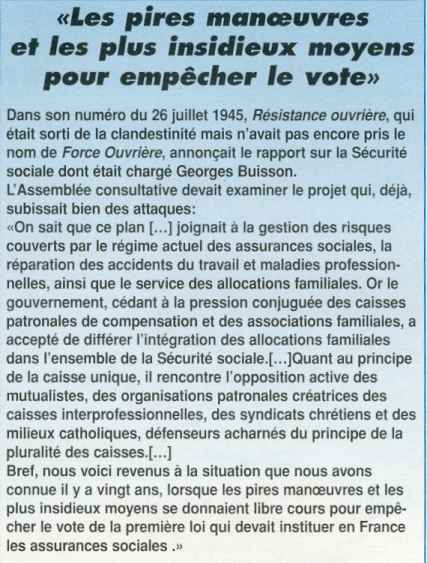|
La Sécu, votre
Sécu, plus d'un demi-siècle d'une existence qui a bouleversé
celle de tout un peuple. Loin de l'édifice sorti tout construit
d'un programme politique, comme on aime à la présenter, elle
est d'abord l'œuvre des syndicalistes. En fait, elle est un concentré de
ces réformes que le syndicalisme peut faire aboutir. Sa naissance,
préparée dans la clandestinité, fut plus difficile que l'unanimisme
actuel ne le laisse supposer.
Avec un enthousiasme qui ne peut se mesurer qu'à l'horreur subie pendant
plusieurs années, les artisans de la Libération sont à l'œuvre en
cette fin de Deuxième Guerre mondiale. Parmi leurs réalisations, l'une
de celles que retiendra le plus l'Histoire est sans conteste la Sécurité
sociale, que les ordonnances du 4 octobre 1945 mettent définitivement en
place.
L'HÉRITAGE DES
ASSURANCES SOCIALES
Définitivement ? Les
débats actuels méritent qu'on y regarde de plus près. Tout comme il
faut regarder de plus ores ce bel ensemble qui a présidé, dit-on, à la
définition de l'institution qui. aujourd'hui encore, permet à la France
d'être un pays où l'égalité m est pas un vain mot.
Contrairement à ce qu'affirment différents hommes politiques la
Sécurité sociale n'est pas une réalisation du seul gouvernement de la
Libération mais d'abord l'œuvre de militants syndicalistes, plus
particulièrement celle de ces responsables de la CGT qu'on appelait
"confédérés", pour les distinguer des "unitaires"
qui étaient en train de coloniser la CGT pour le compte du Parti
communiste. C'est que la protection sociale des salariés est une longue
histoire, dont les acteurs luttent depuis des décennies. Parmi eux,
Georges Buisson,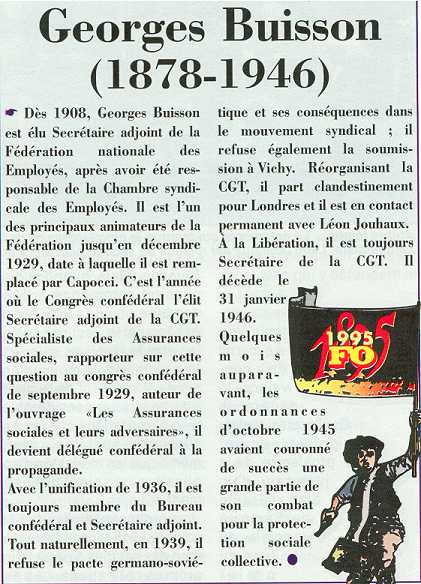 dirigeant de la veille CGT d'avant-guerre et l'un de ses
réorganisateurs dans la clandestinité. En 1943, il rédige un projet
particulièrement précis de Sécurité sociale. Il s'appuyait sur son
expérience de délégué confédéral à la propagande, au moment de la
discussion de la loi sur les Assurances sociales en 1929-1930. Militant
syndical, réformiste convaincu, défenseur des Assurances sociales, il
mesurait mieux que quiconque la portée de l'acquis et, en même temps,
ses limites. dirigeant de la veille CGT d'avant-guerre et l'un de ses
réorganisateurs dans la clandestinité. En 1943, il rédige un projet
particulièrement précis de Sécurité sociale. Il s'appuyait sur son
expérience de délégué confédéral à la propagande, au moment de la
discussion de la loi sur les Assurances sociales en 1929-1930. Militant
syndical, réformiste convaincu, défenseur des Assurances sociales, il
mesurait mieux que quiconque la portée de l'acquis et, en même temps,
ses limites.
Son plan est complet : outre la gratuité complète des soins médicaux,
il considère que la Sécurité sociale, en tant que création ouvrière,
doit être gérée par les seuls travailleurs. Il propose en conséquence
la gestion intégrale par les assurés, sans intervention de l'État. Il
propose également la couverture de l'ensemble des risques (vieillesse,
maladie, famille) par une caisse unique.
Signe des temps. le projet Buisson, soumis à l'Assemblée consultative
d'Alger à la fin de 1943, fut rejeté. La mention d'un "plan complet
de Sécurité sociale" fut certes intégrée au programme du Conseil
national de la résistance, ce qui était une avancée importante pour les
militants syndicaux, mais la gestion de cette Sécu était définie comme
"appartenant aux représentants des intéressés et de l'État".
La dangereuse et extensible notion de tutelle venait de faire son
apparition.
Les syndicalistes poursuivent cependant leur combat. Certes, à l'automne
1944, une délégation de la CGT essaie vainement de convaincre le
général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, de la justesse
d'un plan détaillé de Sécurité sociale du type du projet Buisson. Mais
quand la discussion commence à l'Assemblée en juin 1945, le fait est
acquis : la Sécurité sociale verra le jour. Les salariés, leurs
familles, le mouvement syndical viennent de remporter une victoire
considérable, bien plus étendue que les Assurances sociales, avant même
que les modalités d'application ne soient précisément définies.
Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 reconnaissent le droit des
salariés à gérer leurs propres cotisations. Les aspects immédiats vont
bouleverser la vie quotidienne de millions de travailleurs, avec la
couverture du risque maladie. du risque vieillesse et les allocations
familiales, tous risques gérés de manière uniforme sur l'ensemble du
territoire et pour l'ensemble des professions, à quelques exceptions
près (les régimes dits "particuliers"). Cet acquis ouvrier de
la Sécurité sociale s'inscrit comme une modification positive et durable
pour l'ensemble de la population. Ainsi, par exemple, le suivi médical de
la femme enceinte et du nourrisson, lié au versement des prestations
familiales, va pratiquement éradiquer la mortalité infantile en France.
Outre ces aspects, qui sont loin d'être négligeables, c'est l'existence
même du monde du travail, donc du mouvement syndical et son rôle qui
sont reconnus, non seulement de fait mais dans les textes. Les
travailleurs ont le droit de s'organiser, le droit de cotiser, et de
gérer leurs cotisations par le biais de l'organisation syndicale.
C'est le même mouvement d'un réformisme conquérant qui trouvera son
expression avec la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives
et la liberté de négocier les salaires et les conditions de travail.
Création des militants de la vieille CGT, la Sécurité sociale est à la
fois le modèle et le symbole du syndicalisme.
Est-ce à dire que les ordonnances de 1945 sont parfaites ? Aucun texte ne
peut jamais l'être, et l'existence de la tutelle gouvernementale comme la
place réservée aux employeurs dans les Conseils d'administration des
caisses de Sécurité sociale -- à la différence du projet Buisson --
vont constituer de réels problèmes. L'essentiel n'est cependant pas là,
mais dans l'inscription de l'action syndicale au quotidien pour des
millions de personnes.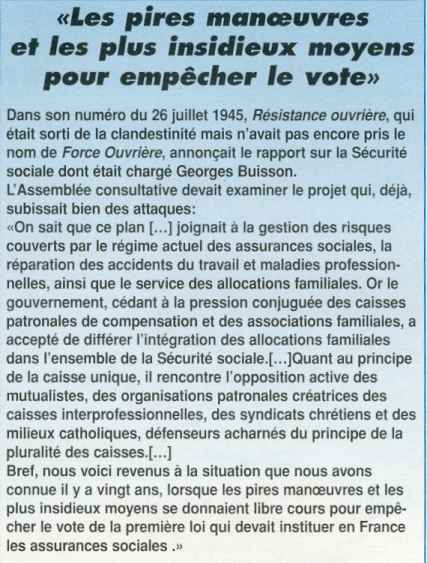
LA CAISSE UNIQUE
REFUSÉE
Une autre limite est
imposée aux ambitions du projet Buisson : il n'y aura pas une caisse
unique de Sécurité sociale regroupant l'assurance maladie, l'assurance
vieillesse et les allocations familiales. Contre cette solidarité
"par construction" entre les générations, des forces
politiques se manifestent opérant des rapprochements paradoxaux, au moins
en apparence.
L'une de ces forces est le Parti communiste qui, par ses dirigeants --les
uns au gouvernement de l'époque, comme Maurice Thorez ou Ambroise Croizat,
les autres infiltrant les sommets de la CGT, comme Benoît Frachon et
Henri Reynaud -- va chercher à déstabiliser le mouvement syndical, en
limitant son audience comme en combattant ses réalisations.
Une autre force est le Mouvement républicain populaire, de tendance
démocrate-chrétienne, qui s'efforce de créer, à l'encontre de la
caisse unique de Sécurité sociale, des caisses d'allocations familiales,
autonomes par rapport à la Sécurité sociale proprement dite. Cette
exigence est relayée par le Parti communiste qui participe lui aussi au
gouvernement tripartite.
Ambroise Croizat, ministre PCF du Travail et présenté par d'aucuns comme
le père de la Sécurité sociale, commence par diminuer des deux tiers à
la moitié la proportion des représentants salariés dans les Conseils
d'administration des caisses d'allocations familiales. Ensuite, Henri
Reynaud, éminent responsable PCF entre en scène. Lui qui a combattu avec
véhémence les Assurances sociales des années 30, qualifiées par lui de
"social-fascistes", présidait à l'époque la Fédération
nationale des Organismes de Sécurité sociale. Il se prononce en
décembre 1946 pour l'autonomie administrative et financière des
allocations familiales vis-à-vis de la Sécurité sociale. Forts de cette
importante prise de position, les pouvoirs publics mettent en place cette
autonomie en créant l'Union nationale des Caisses d'allocations
familiales, qui va durer jusqu'aux ordonnances de 1967. Cette création
tend à séparer chacune des branches de la Sécu (maladie, vieillesse,
famille) et préfigure toutes les tentatives d'éclatement de la Sécu.
Georges Buisson combattait pour les Assurances sociales, Henri Reynaud les
refusait Georges Buisson préconisait une caisse unique de Sécurité
sociale. Henri Reynaud organisait l'éclatement de celle-ci. Georges
Buisson était un militant responsable de la tendance confédérée ; en
tant que tel, il refusait la subordination du mouvement syndical aux
partis politiques.
Cinquante ans après, la Sécu à certes évolué. Elle est aussi soumise
à des pressions et des menaces, mais qui peut dire que l'indépendance
des syndicalistes qui y défendent les intérêts des salariés soit une
nécessite d'un autre temps ? Sur ce plan-là au moins, rien n'a changé
ni depuis 1945, ni depuis 1895, quand la CGT se fondait sur le principe de
l'indépendance. |
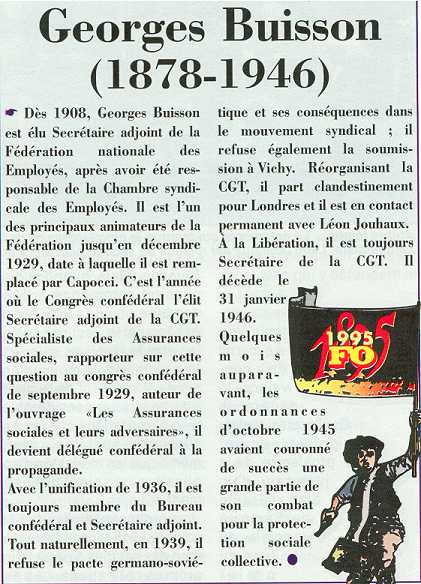 dirigeant de la veille CGT d'avant-guerre et l'un de ses
réorganisateurs dans la clandestinité. En 1943, il rédige un projet
particulièrement précis de Sécurité sociale. Il s'appuyait sur son
expérience de délégué confédéral à la propagande, au moment de la
discussion de la loi sur les Assurances sociales en 1929-1930. Militant
syndical, réformiste convaincu, défenseur des Assurances sociales, il
mesurait mieux que quiconque la portée de l'acquis et, en même temps,
ses limites.
dirigeant de la veille CGT d'avant-guerre et l'un de ses
réorganisateurs dans la clandestinité. En 1943, il rédige un projet
particulièrement précis de Sécurité sociale. Il s'appuyait sur son
expérience de délégué confédéral à la propagande, au moment de la
discussion de la loi sur les Assurances sociales en 1929-1930. Militant
syndical, réformiste convaincu, défenseur des Assurances sociales, il
mesurait mieux que quiconque la portée de l'acquis et, en même temps,
ses limites.